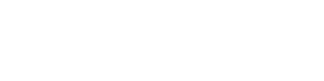1.5.2018, Aude Haenni / Une surface de jeu synthétique est utilisable trois fois plus longtemps qu’un terrain naturel.
Fabriqués à partir de pneus recyclés, des terrains de foot contiendraient des substances nocives pour les usagers.
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/clients/510c1f5629992f3e3984a26f95ea0996/sites/staging.frc.ch/wp-content/plugins/user-specific-content/User-Specific-Content.php on line 373
Dans le milieu du sport, la rumeur court depuis dix ans déjà: les terrains de foot en gazon synthétique renfermeraient des substances nuisibles pour la santé. En cause, leur composition à base de granulats de caoutchouc fabriqués à partir de pneus recyclés (SBR). En 2016, la FRC s’était penchée sur le sujet, mais les communes se préoccupaient alors davantage des revêtements des places de jeux (Sols sous surveillance, FRC Mieux choisir n°89).
Les enquêtes de So Foot (hiver 2017) et celle de l’émission française Envoyé spécial (mars 2018) font à nouveau enfler la rumeur. Redonner une deuxième vie aux objets est louable, si ce n’est que ces pneus contiennent, entre autres, des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), qui sont produits durant les processus de combustion. Les HAP sont potentiellement cancérogènes et peuvent aussi affecter la reproduction ou le développement foetal.
L’Office fédéral de la santé publique (OFSP), en mai 2017, déclarait que «diverses études ont montré que les voies d’exposition sont négligeables». La référence portait sur les travaux de l’Institut hollandais d’évaluation des risques (RIVM) et de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), notamment. A nouveau contacté par la FRC, l’OFSP note que «ces granulats contiennent certes des substances potentiellement toxiques, mais [considère que] les expositions sont basses et ne représentent pas un risque». Si ce n’est qu’à ce jour, aucune étude n’a été réalisée sur d’éventuels effets à long terme… Et certains s’en inquiètent.
Directeur de l’Unité toxicologique de l’Université d’Amsterdam, Jacob de Boer explique notamment dans le reportage de France 2 que «les risques sont sous-évalués» pour un footballeur qui s’entraînerait plusieurs fois par semaine de nombreuses années durant. Ce d’autant plus que 190 substances nocives répondent aux critères de seuil indiquant un potentiel cancérogène dans ces revêtements, selon Vasilis Vasiliou, toxicologue et professeur d’épidémiologie à la Yale School of Public Health, et ses équipes qui ont inventorié les substances présentes dans ces granulats.
Dans le postulat «Nos terrains de sport ne sont pas des décharges à ciel ouvert!» déposé au Grand Conseil vaudois en mars dernier, Jean-François Chapuisat et consorts notent par ailleurs que les directives européennes sur la limite maximale des HAP dans les plastiques des jouets pour enfants est fixée à 0,5 mg/kg, alors que la norme pour les terrains de foot est la même que celle des pneus, soit 1000 mg/kg… Au vu de ces éléments, ne vaut-il pas mieux prévenir que guérir?
Les parades existent
Certaines autorités, à l’instar de celles de New York, Amsterdam ou Paris, ont pris la décision de ne plus construire de nouvelles pelouses artificielles. D’autres ont opté pour une solution moins radicale et néanmoins durable: le synthétique naturel, à base de liège organique ou de fibres de coco…
Quant aux surfaces existantes, l’ECHA suggère diverses mesures pour pallier les incertitudes «liées à ces données et à l’importation potentielle de pneus ou de granulats de qualité incertaine». Tout d’abord, limiter les quantités de HAP et autres substances dangereuses au moment de la production. Ensuite, inciter les propriétaires et exploitants de terrains à effectuer des mesures de concentration, et, dans le cas d’espaces fermés, procéder à une ventilation adéquate. Les joueurs, de leur côté, prendront soin de respecter certaines mesures d’hygiène: se laver les mains, nettoyer les blessures et le matériel après chaque match pour limiter les expositions de contact.